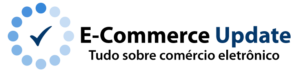Criada em 2004 e reformulada em 2016, a Lei de Inovação (Lei 13.243) tem como principal função criar um ambiente seguro para a colaboração entre empresas, instituições de pesquisa e o poder público. Mais do que apenas um conjunto de regras, a legislação representa uma estratégia para garantir que o Brasil consiga transformar conhecimento em desenvolvimento econômico e políticas públicas mais eficazes.
Para o consultor jurídico da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa do Agronegócio (Fundepag), sócio-fundador de Silva Ribeiro Advogados Associados, doutor e mestre pela PUC/SP e professor de Processo Civil da PUC-SP/COGEAE, Leonardo Ribeiro, a lei permite, de forma sólida e segura, uma parceria entre vários atores, como órgãos públicos, instituições de pesquisa públicas, empresas privadas e organizações do terceiro setor, para que todos possam buscar soluções inovadoras.
Segundo o advogado, um dos méritos da lei é romper com a ideia, ainda comum, de que contratos com o poder público são sempre desequilibrados e burocráticos. “Há um certo temor das instituições privadas em se aliar ao poder público. A lógica que se tem, e que é equivocada, é que essas parcerias trazem cláusulas abusivas. A Lei de Inovação não parte dessa premissa, pelo contrário, ela cria instrumentos jurídicos que viabilizam uma relação mais equilibrada, mais horizontal”.
Já, o procurador do Estado de São Paulo, coordenador do Núcleo Temático de Propriedade Intelectual e Inovação da PGE/SP, mestre em Direito Econômico, doutor (Ph.D) em Direito Administrativo, Rafael Carvalho de Fassio, destaca que inovar é mais do que um diferencial competitivo: é uma necessidade. “Inovação não é algo que fazemos porque é bacana. Inovar é uma estratégia de sobrevivência. Para a empresa, é o que permite se manter no mercado; para o Estado, é uma ferramenta de crescimento e desenvolvimento”.
Fassio lembra que a legislação surgiu diante da percepção de que o direito administrativo tradicional não oferecia mecanismos adequados para parcerias voltadas à inovação. “Quase nada do que está na lei era impossível de ser feito antes. O que ela fez foi facilitar, simplificar e oferecer segurança jurídica, sendo uma resposta à ineficiência das vias tradicionais do Estado”, observa. Para ele, a principal premissa da legislação é justamente a parceria. “Ninguém cresce sozinho. O setor privado precisa do capital intelectual das instituições públicas e o Estado necessita do investimento e da agilidade das empresas. A lei de inovação tenta facilitar esse encontro”.
Na prática, para uma empresa interessada em inovar, o primeiro passo é identificar qual é a dor que se deseja resolver, seja um produto, um serviço ou um processo. A partir daí, a legislação permite firmar parcerias com instituições públicas ou privadas de pesquisa. “O importante é que todos esses atores estão à disposição e a lei traz os mecanismos para que as parcerias ocorram com segurança”, afirma Leonardo Ribeiro.
Essas colaborações podem gerar soluções que, além de atender às demandas de mercado, se transformem em propriedade intelectual compartilhada, contribuindo para gerar receita, fortalecer o ecossistema científico e beneficiar a sociedade.
Controles e segurança jurídica
Embora traga mais flexibilidade, a Lei de Inovação também prevê mecanismos de controle e acompanhamento. “Ela propõe instrumentos jurídicos de prateleira para formalizar as parcerias. Há o controle jurídico, o controle de execução, durante a vigência da parceria, e, em caso de uso de recurso público, a prestação de contas”, explica Ribeiro.
De acordo com o procurador, o controle é um tema delicado, especialmente na administração pública. “O gestor público, por medo da responsabilização, muitas vezes evita caminhos inovadores e reproduz práticas já conhecidas. A lei ajuda a reduzir esse receio ao oferecer segurança jurídica para ações mais ousadas”.
O desafio, segundo os especialistas, é cultural. “É preciso ter humildade intelectual. A empresa precisa reconhecer o valor do conhecimento que está no setor público e o Estado precisa entender a importância do investimento privado para a pesquisa. A Lei de Inovação serve exatamente para viabilizar essas trocas de forma justa, eficiente e segura”, aponta Fassio.
Inteligência artificial e inovação: uma convergência inevitável
A recente popularização da inteligência artificial (IA), especialmente com ferramentas como o ChatGPT, tem aproximado o debate sobre inovação para públicos que antes não se viam inseridos nesse contexto. Para os especialistas, esse movimento pode ser decisivo para ampliar o entendimento sobre a importância da Lei de Inovação.
“A inteligência artificial ficou muito mais próxima da gente. Quando o ChatGPT foi socializado, todo mundo passou a discutir qual seria o impacto dessa tecnologia na saúde, no emprego, no direito, no jornalismo. Esse debate saiu do meio acadêmico e passou a fazer parte do cotidiano. Isso ajuda a aproximar quem não está tradicionalmente envolvido com inovação a compreender o quanto esses avanços impactam diretamente em nossas vidas”, explica Fassio.
Segundo o procurador, ao perceber que tecnologias como a IA já estão transformando a forma como as pessoas trabalham e tomam decisões, empresas e instituições começam a buscar com mais interesse os instrumentos legais que permitem viabilizar projetos inovadores, e é nesse ponto que a Lei de Inovação cumpre um papel fundamental.
Leonardo Ribeiro, que também pesquisa o tema em nível acadêmico, compartilha da mesma visão. “Inteligência artificial é inovação na veia. Ela veio para revolucionar a nossa relação com o mundo, com os nossos empregos e com tudo o que fazemos”, afirma. Embora ainda estejamos, segundo o advogado, lidando com o que se chama de “inteligência artificial fraca”, ou seja, sistemas especializados em tarefas específicas, sem autonomia ou consciência, o potencial transformador já é evidente. “Quando avançarmos para uma inteligência artificial forte, aí sim será uma revolução. Hoje, tarefas que levariam dias para um ser humano executar são resolvidas em segundos. Mas é preciso saber utilizar bem essa ferramenta, porque ela, de fato, muda tudo”.
Na visão dos especialistas, a inteligência artificial não apenas é uma aliada da inovação, mas será cada vez mais central nos processos de pesquisa, desenvolvimento e formulação de políticas públicas. “Ela será um parceiro importantíssimo para quem deseja inovar, tanto no setor público quanto no setor privado”, prevê Ribeiro.
Propriedade intelectual, segurança jurídica e equilíbrio entre os parceiros
Um dos temas mais sensíveis quando se trata de inovação é a gestão da propriedade intelectual. Segundo Rafael Fassio, é justamente nesse ponto que a Lei de Inovação promove avanços significativos, oferecendo regras claras para proteger criações e assegurar uma repartição justa dos direitos entre os envolvidos.
“Quando tratamos de propriedade intelectual, falamos da proteção de uma criação que, muitas vezes, é fruto da colaboração entre duas ou mais partes, sejam instituições públicas, privadas ou ambas. A Lei de Inovação permite estabelecer critérios proporcionais, com base naquilo que cada parte aportou, seja capital financeiro, conhecimento técnico ou infraestrutura”, explica o procurador.
Além disso, ele destaca que as negociações precisam prever cláusulas de confidencialidade logo no início. “É importante que as partes assinem um termo de sigilo já no começo da negociação. Isso resguarda tanto o público quanto o privado e permite uma conversa mais franca, protegendo eventuais segredos industriais ou estratégicos que possam estar envolvidos no processo”.
Leonardo Ribeiro reforça que esse tipo de proteção não é apenas legítima, mas necessária, inclusive para o setor público. “Havia um preconceito antigo de que o Estado não podia trabalhar com informações sigilosas, porque tudo o que faz deveria ser público. Mas isso é um equívoco. Quando o poder público se envolve em inovação, é natural que precise proteger dados estratégicos até que o projeto esteja maduro”.
Outro paradigma que a lei ajuda a romper é acerca da ideia de que o Estado deve sempre deter a maior parte ou a totalidade dos direitos sobre os resultados de uma parceria. A lógica agora é de negociação horizontal, na qual não há uma prevalência automática do Estado sobre o parceiro privado, e cada um recebe na medida do seu esforço.
De acordo com os especialistas, a legislação permite, inclusive, que a totalidade da propriedade intelectual fique com o parceiro privado, quando isso fizer sentido. “A lei reconhece que cada projeto tem suas particularidades. Ela autoriza que a divisão seja ajustada à realidade da parceria, sem imposições generalistas”, esclarece Fassio.
A transparência também é um pilar importante para o sucesso dessas colaborações. “Após a criação ser finalizada e levada ao mercado, é indispensável manter uma troca constante de informações entre os parceiros. Afinal, a propriedade intelectual se converte em royalties e todos precisam saber o que está sendo feito com o produto ou tecnologia desenvolvida. Sem isso, as relações podem se desgastar e até resultar em disputas jurídicas complexas”, destaca o procurador.
Da mesma forma, Ribeiro acrescenta que a Lei de Inovação garante que o pesquisador público também possa receber pelos frutos de seu trabalho. Ela estabelece com clareza a possibilidade de remuneração, divisão de royalties e exploração comercial, tanto para o ente público quanto para o privado.
A mudança de cultura que a lei estimula, valorizando a confiança mútua, a segurança jurídica e o reconhecimento do esforço proporcional, é, para os especialistas, um passo decisivo rumo a um ambiente mais fértil para a inovação no Brasil.
Desconhecimento e burocracia ainda travam a aplicação da Lei de Inovação
Para além dos entraves legais e institucionais, dois obstáculos centrais ainda comprometem a plena efetividade da Lei de Inovação no Brasil: o desconhecimento por parte dos atores envolvidos e a burocracia excessiva que permeia o setor público.
“Existe um desconhecimento tanto do lado do público, quanto das universidades e instituições de pesquisa. Muitas vezes, quando apresentamos a lei em palestras, as pessoas se surpreendem; ‘nossa, a gente pode fazer tudo isso?’”, conta Fassio. Segundo ele, esse estranhamento revela uma lacuna profunda na comunicação da legislação e na sua apropriação prática pelos agentes públicos.
A burocracia, por sua vez, também se impõe como uma trava recorrente. O chamado “apagão das canetas”, a paralisia decisória causada pelo medo dos gestores públicos de inovar sem respaldo jurídico claro, faz com que muitas administrações sigam operando com os mesmos instrumentos de sempre, mesmo quando eles se mostram obsoletos. “O gestor prefere usar o que conhece, o que faz há 20 anos, a correr o risco de responder por algo novo”, explica Fassio.
Para tentar contornar esse cenário, iniciativas como o Toolkit do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, desenvolvido pela Procuradoria do Estado de São Paulo, têm oferecido soluções práticas. Com a proposta de simplificar, o projeto reúne documentos-modelo e orientações passo a passo para a aplicação segura dos instrumentos jurídicos previstos no marco legal, funcionando como uma espécie de “tutorial jurídico” para os gestores públicos.
“Começamos com 10 documentos em 2021, hoje já temos 12 e vamos ampliar para 15. É um projeto que se tornou referência nacional e tem sido usado por outros estados e instituições”, destaca o procurador. A iniciativa também está sendo internacionalizada com versões bilíngues (português-inglês e português-espanhol), com apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e do Brasil Lab.
Ainda assim, há entraves estruturais que dificultam a uniformização de procedimentos. Como lembra o advogado Leonardo Ribeiro, há uma disparidade significativa entre os instrumentos utilizados em diferentes esferas de governo. Enquanto o Toolkit é bastante usado em São Paulo, no nível federal ainda prevalecem modelos distintos, mais complexos e que não dialogam diretamente com os estaduais.
Essa divergência normativa acaba gerando insegurança jurídica para os entes públicos e privados que desejam estabelecer parcerias em ciência, tecnologia e inovação. “Quanto mais modelos pré-aprovados tivermos, melhor. Isso traz segurança tanto para o ordenador de despesas quanto para o empresário que quer investir”, reforça Ribeiro.
Fundações de apoio como elo estratégico
Presentes em diversos projetos de inovação, as fundações de apoio, como a Fundepag, cumprem uma função estratégica ao operacionalizar as ações, contratar pessoal e gerenciar recursos de forma mais ágil do que a administração direta.
“As instituições que têm fundações de apoio são justamente as que mais aplicam a lei. Isso é um dado empírico, não uma opinião”, enfatiza Fassio. A atuação das fundações permite contornar, em parte, a lentidão dos processos administrativos tradicionais, especialmente em áreas como suprimentos e gestão financeira de projetos.
Apesar disso, tanto os representantes do setor público quanto da iniciativa privada precisam ajustar suas expectativas. “O empresário precisa entender que, ao contratar com o Estado, não é possível impor as regras do setor privado. Existe um conjunto de normas específicas que garantem isonomia e controle”, pondera Ribeiro. Para ele, a busca por um meio-termo, com maior compreensão e flexibilidade de ambas as partes, é necessária para destravar as parcerias.
Embora os avanços sejam reais, há um longo caminho pela frente. A uniformização de entendimentos jurídicos, a maior disseminação de modelos como o Toolkit e o fortalecimento das fundações de apoio são peças-chave para tornar o Brasil um ambiente mais favorável à inovação. “Inovação é algo rápido. E o poder público, muitas vezes, não tem estrutura para acompanhar essa velocidade. Por isso, quanto mais instrumentos jurídicos prontos e seguros tivermos, melhor para todos os lados”, conclui Leonardo Ribeiro.