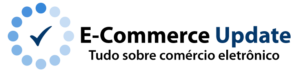Em meio à intensa polarização política no Brasil e ao crescimento de canais de opinião nas redes sociais, o nome do ministro Alexandre de Moraes voltou ao centro das discussões após rumores sobre possíveis sanções internacionais contra sua atuação no Supremo Tribunal Federal (STF).
As especulações ganharam força após a divulgação de que uma suposta carta do governo dos Estados Unidos teria sido enviada ao ministro, em tom de advertência, sobre seus “abusos de autoridade”. O caso provocou reações exaltadas de comentaristas políticos e influenciadores, que passaram a prever bloqueios de bens, cancelamento de vistos e até prisão, com base na chamada “Lei Magnitsky”.
Para o advogado Daniel Toledo, especialista em Direito Internacional, doutor em direito Constitucional e fundador do escritório Toledo e Advogados Associados, é necessário cautela e conhecimento técnico ao abordar o tema. “Muitos vídeos e postagens estão propagando uma série de equívocos jurídicos. A Lei Magnitsky, por exemplo, tem objetivos muito específicos. Ela surgiu nos EUA em 2012 para punir envolvidos em violações graves de direitos humanos e corrupção internacional. Não se aplica de forma automática a qualquer autoridade estrangeira”, alerta.
Toledo destaca que, mesmo nos casos em que sanções são impostas, como ocorreu com autoridades da Rússia durante a guerra na Ucrânia, não há vínculo direto com decisões judiciais internas ou com ações políticas de um país soberano. “É importante lembrar que os Estados Unidos não precisam da Lei Magnitsky para restringir vistos ou congelar ativos. O governo americano já possui meios administrativos para isso. E, até o momento, não há qualquer prova de que essas sanções estejam sendo aplicadas a ministros do STF”, observa.
O papel do YouTube e o debate sobre censura
Parte da controvérsia também envolve decisões do ministro Alexandre de Moraes relacionadas à retirada de conteúdos e perfis em plataformas como o YouTube e o X (ex-Twitter). A discussão se agravou após o empresário Elon Musk desafiar determinações do STF, argumentando que sua empresa não poderia ser penalizada por cumprir a legislação dos Estados Unidos.
Para Toledo, as plataformas que atuam comercialmente no Brasil precisam obedecer à legislação brasileira. “Se uma empresa estrangeira atua em território nacional, oferece serviços e lucra com publicidade dirigida a brasileiros, ela está sujeita às leis locais. Isso inclui, por exemplo, o Marco Civil da Internet e o Código de Defesa do Consumidor. O mesmo vale para obrigações tributárias, representação legal e responsabilidade por conteúdos ilícitos hospedados em seus domínios”, esclarece.
Ele lembra que, embora decisões judiciais possam ser discutidas e eventualmente revistas, ignorá-las pode configurar desobediência e gerar medidas como bloqueios e sanções econômicas. “O impasse com Elon Musk, por exemplo, não é sobre liberdade de expressão, mas sobre jurisdição. O Supremo Tribunal Federal entendeu que a plataforma estava sendo utilizada para disseminar conteúdos que violavam a legislação brasileira, e exigiu providências. Discutir a medida é legítimo. Ignorar completamente, não”, pontua.
Interpretações distorcidas da lei alimentam desinformação
Toledo também critica a forma como influenciadores têm interpretado trechos de leis americanas e brasileiras para sustentar teorias sobre o suposto cerco internacional a Moraes. “É comum ver pessoas sem formação jurídica pegando parágrafos isolados e distorcendo o sentido original das normas. A Lei Magnitsky, por exemplo, não prevê punições automáticas. Ela exige investigações, evidências concretas e um processo criterioso de aplicação”, analisa.
Ele observa que a internet se tornou terreno fértil para o sensacionalismo. “Muitos canais estão mais preocupados em monetizar o engajamento do que em esclarecer juridicamente o que está acontecendo. Com isso, inflamam a população, geram expectativas irreais e contribuem para o descrédito das instituições”, afirma.
Um ponto crítico, segundo Toledo, é que esse cenário de desinformação acaba provocando impactos concretos na vida da população. “Muita gente começa a acreditar que um ministro será preso por uma carta dos Estados Unidos. Outros acham que basta obter dupla cidadania para não responder mais à Justiça brasileira. São visões completamente equivocadas que só alimentam a instabilidade”, destaca.
Ele ainda lembra que, em casos de eventual processo contra um ministro do STF em cortes internacionais, quem arca com os custos da defesa é o contribuinte. “Processos dessa natureza custam caro. Escritórios nos EUA cobram valores altíssimos por hora. Se um ministro brasileiro for processado no exterior por sua atuação funcional, os custos serão cobertos com recursos públicos. É o cidadão quem paga essa conta”, adverte.
Liberdade de expressão não é anonimato
Por fim, Toledo reforça que a Constituição Brasileira garante a liberdade de expressão, mas veda o anonimato. “Qualquer pessoa pode se manifestar livremente, inclusive com críticas às autoridades. No entanto, precisa se identificar e responder por suas declarações. Criar perfis falsos ou páginas anônimas para disseminar acusações sem provas não é liberdade de expressão. É covardia e, muitas vezes, crime”, conclui.
O advogado defende que o debate sobre os limites do Judiciário e da liberdade de imprensa é legítimo, mas deve ser feito com responsabilidade. “É preciso mais educação jurídica e menos espetáculo. A verdade jurídica não cabe em manchetes inflamadas. Ela exige estudo, ponderação e compromisso com os fatos”, finaliza.